Lubna ➶ - 3 juillet 2025 - 15 min de lecture
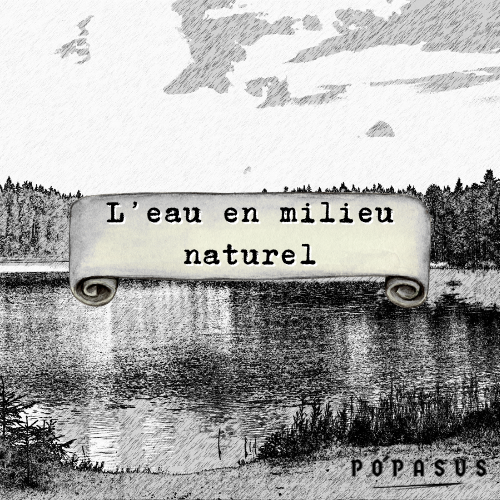
"l'absolue priorité après la sécurité"
3 jours sans boire est une limite longue.
Ton corps est composé à 75% de flotte, elle sert ta régulation thermique, permet à tes reins de faire leur job et est essentielle à ta transmission nerveuse.
Sans oublier qu'une bonne hydratation prévient des coups de chaleur !
La respiration, la transpiration, la digestion, tout ça consomme de l'eau. Vomissements et diarrhée en font perdre encore plus.
La dépense pour un individu moyen est de 2 à 3 litres par jour. Même au repos, à l’ombre à ne rien faire 24 heures durant, tu en perds 1 litre. Du liquide qui doit être remplacé pour conserver un équilibre aqueux convenable.
Soit en buvant, soit en absorbant celle présente dans la nourriture.
Ainsi, être en mesure de trouver de l’eau et de la purifier est indissociable de la vie de terrain. Plus tu en auras à disposition, plus ton corps pourra se permettre d’en utiliser pour fonctionner.
Tu trouveras ici :
➵ les risques liés à l'eau
➵ ce qu’une bonne hydratation
➵ la flotte en milieu aride et tropical
➵ comment en trouver et la rendre potable
➵ les pratiques à observer par manque d’eau
Étant une pratiquante de la nature rompue à la dégradation, je ne fais volontairement pas référence aux gadgets sophistiqués. Soit parce que leur solidité ou leur durée dans le temps reste à prouver. Soit de par leur médiocre rapport poids/encombrement.
Néanmoins, je ne dénigre en rien l'efficacité et la potentielle utilisation de ces outils sur le court terme.
Bonne lecture !

Simple. Elle est claire, non colorée, sans particules, et contient un minimum de sels minéraux.
Il est à savoir que l’eau issue de la pluie, de la fonte de neige et de glace est déminéralisée. Tout comme celle de la rosée, celle obtenue par condensation ou distillation. Par conséquent, il est nécessaire de la reminéraliser pour s’hydrater. Une pincée de sel, un morceau de cube pour bouillon ou quelques gouttes de sérum physiologique suffisent.
Tu peux aussi faire une infusion. Ou boire en mangeant, même si ce n’est pas la meilleure des options, on voit pourquoi dans la partie suivante.
En ce qui concerne la neige, n’en ingère jamais sans l’avoir fait fondre au préalable.
Pareil pour la glace. Puis laisse de côté celle de formation récente qui est blanche et irrégulière. Préfère celle qui est plus ancienne, reconnaissable à ses arrondis et ses reflets bleutés.

Commençons par le commencement, bois avant d’en ressentir le besoin.
Une bouche humide, des envies d’uriner fréquentes qui donnent des mixtures claires et volumineuses sont d’excellents signaux.
Une cavité buccale sèche, des urines foncées et peu quantitatives, montre que ton corps est en mode économie. Ce qui n’est, tu t’en doutes, pas bon.
C’est le gros intestin qui absorbe la majeure partie de la flotte que tu ingères. Si t’a rien dans le ventre un liquide l’atteindra en 20 minutes max. Mais il mettra plus ou moins 3h si tu viens de manger. Selon la taille du repas.
Le mieux est donc de se désaltérer 30 minutes avant de manger. Et d’en absorber en continue le reste de la journée. Idéalement par petites gorgées que tu fais circuler en bouche avant d’avaler pour bien humidifier tes muqueuses.
Dans ces conditions, le risque de boire trop, trop vite, est l’œdème cérébral.
Mange d’abord quelque chose de salé (cube pour bouillon, pincée de sel, …) ou bois une toute petite dose d’eau salée (ne provenant pas de la mer). Attends un peu et essaye d’ingurgiter un peu d’eau potable. Si elle te dégoûte, attends encore.
Surtout ne force pas, vomir t’assécherait encore plus !
Patiente jusqu’à ce que l’envie de boire revienne réellement. Puis tu y vas crescendo en buvant de plus en plus.
Te voilà sur la voie de la réhydratation. Tu le seras complètement quand tes urines seront claires et abondantes.
Et note qu'il est toujours bon d'avoir en sa musette des solutés de réhydratation orale à dissoudre dans l'eau.

Sans source à disposition, ne t’agite pas et aborde chaque tâche avec efficience. Couvre-toi, laissant le moins de surface possible de ton corps à l’air libre.
Mange peu si ce n’est pas du tout, évite la graisse qui demande beaucoup d’eau pour être digérée.
S'il y a réel manque, humidifie seulement tes lèvres et suce un petit caillou pour diminuer la sensation de soif. Respire par le nez en gardant la bouche fermée. Pas de blabla, pas de clope, pas d’alcool.
Reste un maximum à l’ombre, quitte à construire un abri pour la journée et à te déplacer de nuit. Veille à ne pas te coucher sur une surface trop chaude.
Enfin, économise la ressource au point de ne pas l’utiliser pour l'hygiène. Les lingettes sont plus qu'appréciées dans ce genre de situation, particulièrement dans le désert où l’on dispose rarement d’une source permanente.

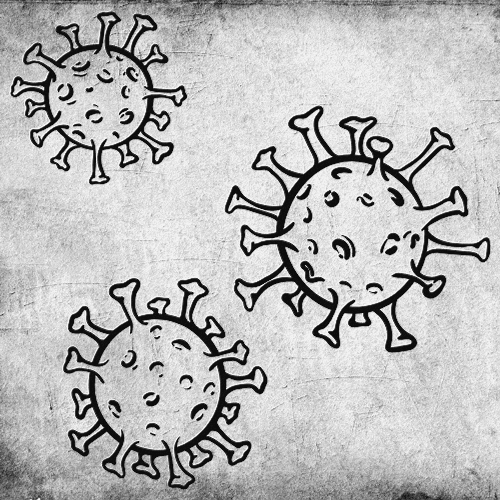
"NBC - nucléaire, biologique, chimique"
- Le risque biologique -
C’est le plus présent dans la nature. Il se compose des parasites, des protozoaires, des bactéries et des virus.
Les protozoaires sont faciles à filtrer. En plus d’être sensibles aux traitements chimiques et à l'ébullition.
Les parasites sont encore plus simples à filtrer mais ils résistent bien aux traitements chimiques. En revanche l'ébullition fait le job.
Les bactéries, plus petites que les 2 agents pathogènes précédents, nécessitent un filtre serré (0,2 micron) pour être retirées par filtration. Mais les traitements chimiques et l'ébullition les éliminent.
Les virus sont microscopiques, oublie l’idée de les avoir avec un filtre. Certains sont en plus résistants à la chaleur. Les traitements chimiques, eux, en viennent à bout.
- Le risque chimique -
Il s’agit des produits dissous qui colorent un liquide. La seule manière d’atténuer ce danger est d’utiliser du charbon finement broyé dans ta méthode de filtration.
- Le risque nucléaire -
Bon là on parle d’une pollution aux particules radioactives.
Lorsque ce type de contamination se produit, il convient d’aller puiser et stocker de l'eau souterraine le plus rapidement possible. Puisque dans un premier temps les particules se trouveront en surface. Elles traverseront les sols avec la pluie.
Pour le coup tu disposes de quelques heures à quelques jours.
Passer le beau temps, seuls les filtres céramique 0,2 micron et osmose inverse limiteront la quantité de radiation dans ta flotte. Pour une seule filtration par filtre seulement, ce dernier devenant lui-même irradié par le passage du liquide radioactif.
Note qu’il n’y a rien à faire pour diminuer le risque lié aux isotopes d'hydrogène. Boire une eau ayant subi une telle pollution est synonyme de décès.
- Indicateurs d'une source contaminée -
➵ l'eau fortement colorée
➵ celle dégageant une forte odeur
➵ source n’étant entourée d’aucune plante
➵ ayant de l'écume ou des bulles à la surface
➵ présence d’os d’animaux à proximité de l’eau
➵ celle entourée de plantes qui ne sont pas vertes et saines
➵ Agglutinement de minéraux sur les bords, indiquant une condition alcaline
Évite les sources stagnantes, souvent entourées de massettes et de roseaux.
Face à un cours d’eau te paraissant pollué, remonte le plus possible en amont vers la source pour puiser ta flotte.

Dans l'optique de rendre l’eau traitable tu cherches à la débarrasser de toute particule en suspension.
Pour le gros du boulot y’a deux écoles. La filtration et la décantation.
La décantation consiste à laisser le liquide au repos dans un contenant. Les particules se déposeront au fond et tu pourras délicatement verser l’eau du dessus, qui elle, sera devenue claire.
La filtration reste une meilleure option puisque plus efficace. S’agissant de faire passer le liquide dans un ou plusieurs composants, qui vont retenir où absorber les agents pathogènes.
- Méthodes de filtration-
Bien entendu, il en existe autant que le bon Dieu peut en bénir. Le mieux étant de combiner plusieurs matériaux dans un seul et même filtre afin d'en cumuler les actions.
Quelque soi l'environnement, rien n'est vraiment inutile. Sur le terrain, utilise ta tête et les connaissances qu'elle contient pour repérer ce dont tu pourrais te servir pour filtrer ta flotte.
Système D quoi. Histoire de trouver mieux que de faire passer l'eau dans une chaussette propre. Même s'il faut admettre que si le liquide est plutôt propre et les particules plutôt grosses, ça peut faire l'affaire.

"filtre portatif"

"trépied filtrant"
Les filtres ci-dessus alternent couches de cailloux, de sable, de charbon et de tissu, afin d'obtenir un liquide clair dépourvu de particules. Le charbon sert à absorber les toxines et à atténuer le risque chimique. Plus il sera finement broyé, plus son action sera efficace.
Sois imaginatif, ce procédé peut être mis en œuvre de différentes manières. Ici tu l'as sous forme de trépied et de bouteille, mais cette même succession de couches dans un sac en tissu ou dans de l'écorce fonctionnera aussi bien.

C’est l’étape finale qui vient compléter la filtration pour rendre l’eau potable.
Le traitement le plus couramment utilisé, parce que le plus simple, n’en est pas vraiment un. C’est l'ébullition. Et tel qu’écrit précédemment, cette dernière laisse certains virus derrière elle.
Néanmoins, en les climats tempérés comme celui de la France, les virus sont moins fréquents et l'ébullition suffit la plupart du temps. Les terrains à risques seront dépeints plus loin dans l'article.
Pour obtenir des résultats plus sûrs, on traite chimiquement le liquide. À titre personnel j’use quand je le juge nécessaire, de tablettes Micropur Forte. Une pastille pour 1 litre d’eau claire, deux pour 1 litre d’eau trouble. Je laisse agir 30 minutes et le tour est joué. Les tablettes Aquatabs sont également très bien.
En été dans l’hémisphère nord et toute l’année sous des latitudes plus ensoleillées, il est possible d’utiliser les rayons ultraviolets du soleil.
Si tu disposes d’une bouteille en plastique transparent. Remplis-la d’eau préalablement filtrée, puis mets-la au soleil. 8 heures sous un ciel radieux, 6 heures par temps couvert.
Plus tu montes en altitude, plus la méthode est efficace.


"poncho récupérateur d'eau"
Elle va toujours là où on lui résiste le moins !
Sur des sols denses et imperméables, tu la trouves en surface. Avec des sols poreux, elle s'infiltre pour réapparaître ailleurs.
Dans un cas comme dans l'autre, tu as de grandes chances d'en trouver là où plusieurs inclinaisons de terrain se rejoignent.
S'agissant de l'absolue priorité après la sécurité, n’attend jamais d’être à court pour aller en chercher. Jamais. Et note qu'un bon équipement de survie à une capacité de stockage allant de 5 à 8 litres.
Lorsque tu décides de rester un minimum dans un lieu assez éloigné d'une source (pas trop quand même hein), n'hésite à te faire un ouvrage de rétention. Puits, trou tapissé d'argile ou d'une bâche. Sans oublier de couvrir ce dernier, ne serait-ce qu'avec la végétation, pour limiter l'évaporation et faire en sorte que le liquide reste le plus propre possible.
Indicateurs généraux de la présence d'eau
➵ les vallées
➵ les sols humides
➵ les traces humaines
➵ les crevasses de montagne
➵ les regroupements d'oiseaux
➵ les pistes d'animaux non carnivores
➵ les zones à la végétation abondante
➵ les groupements de végétaux aimant l'humidité
➵ les colonies d'insectes sociaux comme les abeilles ou les fourmis
➵ là où les falaises plongent dans la mer, quand il y a de la végétation
➵ les lits de rivière et fossé asséché, principalement en régions rocailleuses.
Tu peux obtenir de la flotte en creusant un trou sous un bosquet de végétation, ce dernier pourra alors se remplir.
Sur les côtes, notamment quand il y a des dunes, creuse juste au-dessus des traces laissées par la marée haute. T’as moyen d’obtenir quelques centimètres d’eau potable filtrée par le sable, qui flotteront sur une nappe salée. Par contre ne t’attend pas à ce qu’elle ait bon goût…
Le long des falaises, dans les montagnes, au sein de crevasses, n'hésite pas à te faire une paille de fortune au moyen d'une tige végétale creuse pour aller chercher l’eau.
L’eau issue de la rosée n’est pas à négliger. Pour en récupérer en quantité, entoure tes jambes de tissu et marche dans la végétation. Puis t’essores le tout dans un contenant.
Note que les jeunes pousses sont gorgées d’eau et sont toutes considérées comme comestibles. Constituant par conséquent une solution d’hydratation.
Tout comme les yeux des animaux dont on absorbe le jus en les suçant.
Le long de l’épine dorsale de tous les poissons se trouve un liquide potable. La quantité dépend de la taille de l’animal.
En revanche les autres jus que contiennent ces créatures marines, bien que nourrissant, nécessitent plus d’eau pour être digérés qu’ils n’en apportent.
Certaines grenouilles sont aussi intéressantes en ce sens. Mais il faut déjà savoir faire la différence entre celles qui sont comestibles et celles qui sont venimeuses…
Si t'as le choix entre neige et glace, choisi la glace qui produit 2 fois plus d'eau pour 2 fois moins de chaleur.
Si tu n'as que de la neige sous la main, sache que les couches les plus profondes contiennent le plus de flotte. Et évite de faire fondre un gros bloc d'un coup, tu vas t'emmerder. Liquéfies-en un peu dans le fond de ta gamelle puis rajoute petit à petit.

"arbre à eau"

"condensation végétale"

"arbre à condensation"
La vocation de l'arbre à eau est de récolter la flotte issue de la pluie et de la rosée grâce à un épais tissu enroulé autour d'un tronc.
Placer un plastique en guise de dôme sur une plante ou d'une branche bien fournie permet de récupérer l'humidité par condensation. Pour une efficacité maximale, veille à ce que ce même plastique ne touche pas, ou le moins possible, les feuilles.
Dis-toi bien que les visuels ci-dessus ne sont que des exemples. Une bâche tendue sur 4 piquets en bois, avec une pierre posée sur une des extrémités de cette dernière pour orienter la flotte vers un réceptacle, et tu récupères de l'eau.
Une grande feuille, telles celles présentent en nombre en les régions humides, fera aussi bien l'affaire.
D'une manière ou d'une autre, un esprit orienté solution trouvera toujours le moyen d'obtenir du terrain ce dont il a besoin.

"distillateur d'eau salée"

"distillateur solaire"
Dans l'optique de distiller de l'eau salée, fais-la bouillir dans un récipient couvert d'un épais tissu. Ce dernier va s'imprégner de vapeur et tu n'auras plus qu'à l'essorer pour récupérer le liquide.
Un distillateur solaire fonctionne au moyen d'un trou (1 mètre de large pour 60 centimètres de profondeur) couvert d'une bâche qui chauffe l'air et le sol. En résulte de la vapeur qui se condense sur le plastique. Les gouttes ainsi formées coulent le long de celui-ci jusqu'à tomber dans le réceptacle placé à cet effet.
Fixe solidement la bâche aux bords de la fosse avec de la terre pour que l'eau ne s'écoule pas vers l'extérieur du dispositif. Veille aussi à bien placer la pierre qui oriente les gouttes d'eau obtenue au centre de la bâche, au-dessus du réceptacle.
Ce procédé permet également de distiller de l'eau salée ou contaminée.


"sec comme le désert"
Ce biome occupe 20% du globe. Il existe des déserts de sable, de sel, de roche… mais ils sont tous caractérisés par le manque d’eau. Ainsi que par un environnement sec et venteux propice à la déshydratation.
Économise donc au maximum la ressource et les dépenses de ton corps.
C'est également un environnement à risque, évite autant que possible de puiser ton eau près de zones peuplées. Et sois carré avec la filtration et la purification.
En ce milieu on trouve des lacs sans sortie dont l’eau est devenue salée. Cette dernière doit impérativement être distillée.
Les plantes qui poussent dans les déserts sont de bons indicateurs. Tu trouveras de l’eau entre 60 et 90 cm de profondeur sous les palmiers. De 3 à 3,5m sous les saules et les cotonniers.
Le cactus et la sauge n'apportent aucune précision. De plus, le liquide contenu en leurs tiges et racines ne convient pas à tout le monde. Certains pourront le boire sans soucis, d’autres souffriront de nausées et de trouble gastrique. Ne prends pas de risque en situation dégradée, surtout si tu n'as pas testé les réactions de ton corps à ces plantes au préalable.
Sans parler du fait que certaines cactées, ainsi que leurs fruits, sont vénéneux. Veille à ne boire que le suc des espèces que tu es sûr de reconnaître. Le Sagurao est toxique par exemple, mais il est possible d’en extraire l’eau par condensation.
L’eau des fruitiers tels les baobabs, les caroubiers et les cucurbitas est potable.
Les racines du chêne du désert, de l’arbre à eau et de l’arbre sang contiennent des sucs. Déterrées et écorcées, tu peux les sucer puis les mâcher pour l’extraire.
Les palmes du palmier buri permettent de récolter 1 litre par jour. Courbe une palme, coupe un petit bout à son extrémité et récolte la flotte. Reviens 12 heures plus tard, recoupe un même morceau de cette même palme et c’est reparti.
Tu peux aussi trouver des résurgences en creusant les bords les plus bas, et ombragés si possible, des rivières asséchées.
Chose à savoir, les déserts sont traversés par des pistes sur les bords desquelles, tous les 30 à 160 km, se trouvent des puits destinés aux nomades.
Pour finir, comme toujours les pistes d’animaux non carnivores conduisent à des sources. Mais le meilleur reste les oiseaux. Oasis, mer, civilisation, en zone aride, ils sont toujours le signe de salvatrices nouvelles.


"la loi de la jungle"
En des zones où se trouvent pléthore de rivières, de torrents, de mares, de ruisseaux et de marécages, l’eau n’est pas un problème. Tant que l’on sait en apprécier la qualité…
Puisque le milieu tropical est lui aussi à risque concernant cette ressource. Et il serait vraiment con de s'assécher l'organisme avec une diarrhée ou autre saloperie en voulant s’hydrater… ou pire, de mourir pour raison sanitaire.
Le précieux liquide se trouve en bonne quantité dans les plantes carnivores. Tant qu’il ne paraît pas stagnant c’est ok.
Y’en a aussi pas mal dans les bambous verts. Tu les secoues, banco s’ils font “gloup gloup”. Coupe une section et regarde à l’intérieur. L’eau doit paraître claire, non laiteuse, sans particules.
En moins grande quantité mais à ne pas négliger, les jointures des bambous plus anciens, de couleur jaune, en contiennent. Suis le même procédé.
Les bananiers et les cocotiers peuvent faire office de puits. Évite néanmoins car il faut abattre l’arbre. M’enfin si t’en arrives là, mesure 15 cm à partir du sol et coupe le tronc. La souche et les racines étant creuses, elles seront pleines de flotte.
En ce qui concerne l’arbre du voyageur, il stocke 1 à 2 litres d’eau à la base de ses palmes.
Les cocos vertes de la taille d’un pamplemousse renferment un liquide consommable. Celles qui sont mûres contiennent plus d’huile et rendent malade à s’en retrouver plus déshydraté qu’autre chose.
Les palmes du palmier nipa et du cocotier permettent de récolter 1 litre d’eau par 24h. Même méthode que pour le palmier buri, décrite précédemment dans la partie sur le milieu aride.
Une pulpe très hydratante s’obtient en broyant l’intérieur des cactus coussin de belle-mère. Mais il faut dépenser une grosse quantité d’énergie pour l’obtenir. Ce qui n’est en définitive pas toujours rentable. Généralement il est plus efficient de trouver de l’eau ailleurs.
Sinon, sur le papier, l’opération est simple. Découpe le dessus du cactus et broie l’intérieur jusqu’à pouvoir l’aspirer avec un morceau de bambou.
Les lianes contiennent potentiellement de l’eau. Commence par faire une profonde entaille au plus haut de cette dernière. Si la sève qui sort est laiteuse ou collante, oublie.
Dans le cas contraire, termine de la sectionner au plus haut et coupe-la ensuite au ras du sol. Contrôle visuellement à l’intérieur de la section obtenue la qualité du liquide. S’il est laiteux, oublie.
Claire et non colorée, fais-en couler dans le creux de ta main et attends 10 secondes. Dans le cas où sa couleur ne change guère, tu peux le goûter.
Amer ou acide, oublie. Goût neutre ou de bois c’est ok, tu peux le boire.


© Popasus 2025 - Tous droits réservés