Lubna ➶ - 22 juillet 2025 - 7 min de lecture
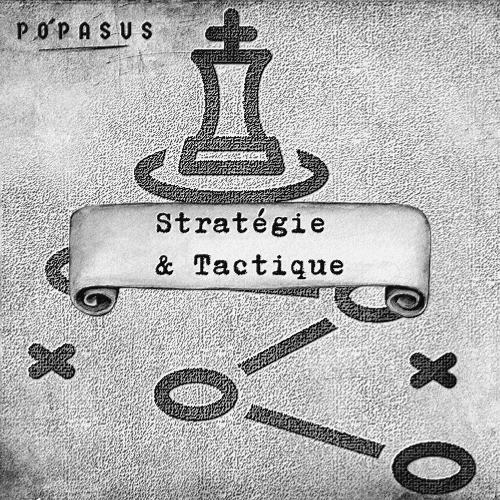
"une aventure intérieure"
Et si les connaissances d’un environnement donné facilitent la priorisation, ça ne fait pas tout. Puisque savoir ne veut pas dire être en capacité de réagir avec bon sens et réalisme en situation d’urgence.
Quand les évènements s'enchaînent et se déchaînent, les émotions et autres bouleversements ont vite fait de prendre le dessus.
En résulte rarement la bonne attitude à adopter, celle qui distingue avec lucidité le plan des idées de la réalité.
Tu trouveras ici :
➵ la méthodologie
➵ la gestion des risques
➵ la stratégie en groupe
➵ la structure et les probabilités
➵ ce que la stratégie et la tactique.
Bonne lecture !

La stratégie est la mise en œuvre de ce qui te mènera à ton objectif final, le seul qui compte vraiment. La tactique, elle, est tout ce qui te permettra d’appliquer ladite stratégie.
Exemples simplifiés :
Les victoires tactiques permettent l'exécution stratégique. Ainsi l’une influence l’autre. Raison pour laquelle il faut être prêt à revoir ses plans au fil de l’eau.
Seul l’objectif final, survivre, demeure inflexible.

Même s'il y a quelques bases, notamment la priorisation et l’organisation, il n’est guère de conduite type d’une situation de survie.
L’unique règle est qu’il n’y en a pas, seul le résultat compte. Revenir avec ses doigts et ses parties bien en place.
S’attendre à un mode d’emploi serait considérer la pratique de la nature comme un sport. Or, tous les animaux qui évoluent en notre biotope survivent avec leurs armes respectives dans des milieux où tricher c’est gagner, où gagner c’est vivre.
Personne n'échappe à cet état de fait.
Il est bien entendu possible de comparer la nature d’une situation à une autre, mais ce n'est guère faisable pour la mise en œuvre de ses solutions.
Peu importe la manière, on cherche à trouver la bonne attitude pour éviter la dégradation ou y faire face. Un esprit positif aussi inflexible envers l’objectif, revenir en vie, que fluide dans ses réflexions.
Pas la peine de changer ton fusil d’épaule si le chemin suivi est déjà bon. Le manque de considération tue autant que de penser à n’en plus finir. Douter jusqu’à l’immobilisme autant que l'excès de confiance.
Ce pourquoi le babla théorique est souvent, très souvent, éloigné de la réalité pratique.
PLAN
Dans l'optique de prioriser on utilise l’acronyme PLAN. Ce dernier est valable où que tu sois sur la planète.
- P pour protection -
D'emblée il faut mettre tes intégrités et celles des autres en sécurité en trouvant ou construisant un abri. Il peut être nécessaire de se déplacer du lieu de l’accident ou de la catastrophe subie pour en trouver un plus sûr.
L’urgence va au soin des blessés (par ordre de gravité, attention à ceux qui sont intransportables qu'il est nécessaire d'abriter sur place). Puis, si besoin est, allume un feu.
- L pour localisation -
Essaie de définir ta position, même si c’est très approximatif. Si tu penses être recherché ou avoir une chance d’être secouru, signale-toi en suivant le principe “voir et être vu” (3 grands feux en triangle, SOS écrit avec des pierres dans le sol…).
Repère les lieux, cartographie, indique ta présence à différents endroits. N’hésite pas à prendre de la hauteur pour définir de potentielles routes. Tu pourrais en avoir besoin si jamais tu décides de bouger.
- A pour approvisionnement -
L’eau en priorité, ce dont tu juges avoir besoin ensuite, et enfin la nourriture.
- N pour navigation -
En mer tu es livré à toi-même, les chances que tu sois retrouvé sont minces. Sur la terre ferme, prends la décision de te déplacer si l'environnement n’est pas propice à la survie, que tu sais d’avance ne pas être recherché, ou que tu te considères capable de t'en sortir seul.
But, moyens, motif
L’efficience de terrain veut que l'énergie ne soit pas inutilement dépensée. Ainsi les actions s'exécutent de la manière la plus calme et intelligente possible.
Dans l'optique d'avoir une conscience globale de la situation, on identifie des buts clairs sans pour autant oublier la flexibilité qui permet de répondre à l'imprévu. On sait pourquoi il est important d'atteindre ces objectifs. On estime les moyens à mettre en œuvre pour ce faire.
Rien n'est plus enfantin que cette équation. Une action plus coûteuse que ce qu’elle rapporte n’est pas seulement inutile, elle est contreproductive.
De même, un motif découlant d’une croyance ou d’une réaction émotionnelle donnera un dessein dont tu n’as pas réellement besoin. Te détournant de ce qui compte vraiment.
Et ça, c’est la bonne recette pour se foutre dans la merde.
Les systèmes
Systématiser permet de simplifier et sécuriser par l’organisation.
Ranger convenablement son sac et ses poches, toujours de la même manière pour trouver sans délai ce qui a son utilité à l’instant T. Une place pour chaque outil, chaque outil à sa place.
Les plus employés à portée directe de la main.
Choisir du matériel low-tech simple à mettre en œuvre. Adopter coup sur coup les mêmes procédés pour allumer le feu, rendre l’eau potable, etc.
Ainsi, ce qui est récurrent devient machinal. Peu importe ton état, que tu sois stressé, blessé, fatigué, dans l'urgence, tu ne rencontres aucune difficulté pour exécuter.
Pas de galères, pas de pertes matérielles, pas d’interminables recherches. Quand c’est systématique c’est sûr, pratique, rapide.
Il va de soi que les organisations les plus opérationnelles naissent et s'optimisent avec l’expérience. Pratiquer, pratiquer, pratiquer.

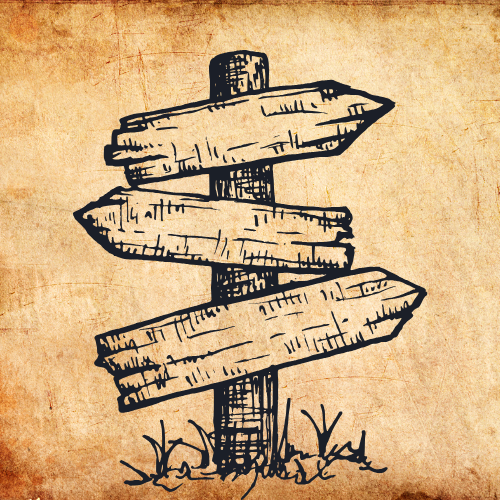
"réalités & possibilités"
Sur le terrain les éléments structurants sont :
➵ toi, le groupe dont tu fais partie
➵ ton matériel, le matériel collectif
➵ les informations vérifiables en ta/votre possession
➵ tes connaissances et compétences, celles du reste du groupe
Le tout représente ta structure. Celle qui se trouve face aux probabilités de l'environnement, de son contexte et de ses évolutions.
Les réalités (structure) et possibilités (probabilités) par rapport à un objectif éloigné (survivre).
Concrètement, on utilise l'acronyme de défense SAEC. Structure, autres, environnement, contexte.
Ci-dessous 2 exemples. L'un concernant le milieu naturel, l'autre le milieu civilisationnel.
- Exemple I. en milieu naturel -
Structure → Suis-je seul ou avec un groupe ? Le groupe est-il aguerri ? Quels équipements avons-nous ?
Autres → Quels sont les animaux, humains compris, ou groupes d’animaux que nous sommes susceptibles de croiser dans cette zone ?
Environnement → Désertique, humide, montagnard, polaire ?
Contexte → L'environnement est-il engagé (militairement parlant) ? Une catastrophe naturelle est-elle en cours ? Suis-je sur les lieux d’un accident (tel un crash) ?
- Exemple II. en milieu urbain, périurbain et rural -
Structure → Je mesure 1 mètre 60 pour 50 kilos ou 1 mètre 90 pour 115 kilos ? Suis-je seul ou accompagné ?
Autres → J’ai plus de chance de croiser des retraités, des voyous, des combattants radicalisés ? Le tout à la fois ?
Environnement → Une calme campagne Suisse ? Les quartiers nord de Marseille ? Aux environs de Bamako ?
Contexte → Je retrouve mon ami Morris devant un centre commercial ? Je vais retirer de l’argent ? Il est 10 heures, 15 heures, 2 heures du matin ?
L'information
Être en mesure de revoir ses stratégies passe par une récolte permanente de données.
Considérer son environnement pour ne pas passer à côté des opportunités, ne pas négliger les dangers, ne pas omettre de remarquer les changements de paramètres.
Rien n’est inutile. Soit ça peut te servir, soit ça peut te nuire.
Le vent dominant, l'orientation des reliefs, le sens dans lequel coulent les cours d'eau, les différentes traces laissées par les animaux, des nuages qui resteraient inchangés jour après jour au même endroit du ciel… sont autant d'informations qui, avec un peu de connaissances, peuvent servir.
Utilise ton savoir, aussi faible puisse-t-il être, pour lire ton environnement.
Si tu ne remarques absolument rien, c’est que tu n'as pas le bon état d’esprit. Que ta concentration est occultée, que tu n’es pas tout à fait dans l’instant présent (peur, stress…).
Sous peur, stress, fatigue, adrénaline...
On en revient toujours à la conscience de soi et de son environnement.
Même s’il est des individus plus inébranlables que d’autres, une situation dégradée est quoi qu’on en dise émotionnellement éprouvante. En découle une altération plus ou moins importante de la conscience.
Il convient donc d’être franc envers soi-même, de remarquer et d’accepter que ses capacités aient changé.
– “Ok je suis stressé là, donc ma motricité sera moindre, mes mouvements seront plus maladroits, ma cognition aura tendance à se focaliser.”
On respire un bon coup si besoin est pour garder la tête froide et les idées claires. Attentif au possible, concentré sur ce qui est à faire ici et maintenant.
La conscience se place là où on a besoin d’elle. Même au bord de l’hypothermie, on n’allume pas un feu en pensant à se réchauffer, on allume un feu en pensant à allumer un feu.
Objectivité
La peur n’exclut pas le danger, l’ignorer est inconscient, lui obéir conduit à créer l’ennemi.
Mettre son énergie dans la résolution de faux problèmes et la réduction de risques artificiels mène au combat contre l’inexistant. Ignorant par conséquent la réalité.
Primordial, avoir peur des vrais dangers et faire abstraction du reste. Mais pour apprécier objectivement une probabilité de risque, encore faut-il être en mesure d’écarter les psychoses imaginaires.
Ce qui peut nécessiter de revoir son conditionnement pour se débarrasser de croyances à la con.
La possibilité de s’imaginer un risque impressionnant, mais qui n’existe pas réellement. Les rumeurs, qui sont rarement fondées. Le matériel, qui ne rend pas immortel. Les figures d’autorité, qui peuvent raconter des conneries. Les traumatismes, qui pourrissent la vie…
De nos jours, nombreux sont ceux qui ne sont pas en capacité de gérer une situation, qu’elle soit d’urgence ou non, de manière objective et rationnelle.
Or en milieu isolé, il est impératif d’y parvenir.

Être unis et organisés est la seule option pour survivre à plusieurs. Peu importent les différences, les préjugés et autres inepties, l’objectif de revenir en vie doit l'emporter.
Attention à l’effet de groupe. Une équipe d’Homo Sapiens au sein de laquelle les rôles sont mal définis est plus stupide que le plus idiot de ses membres.
En la civilisation ça passe, ça fonctionne mal mais ça passe. Dans le monde réel en revanche, la dilution des responsabilités mène à la catastrophe.
Sur ce point le principe militaire de “la fonction prime sur le grade” est à prendre en exemple. Et le principe civil qui consiste à suivre celui qui donne le plus d’espoir, souvent le plus charismatique, est à proscrire.
Un pax n’ayant jamais vu un poisson vivant de sa vie n'aura que peu voix au chapitre dans la mise en œuvre de la pêche.
Il en va de même pour le reste.
Est à mettre à la tête du groupe celui qui a le plus de discernement ou d’expérience. Est à mettre à l’orientation celui qui a les meilleures capacités de navigation. Décide de la construction des abris celui qui est calé sur les échanges de chaleur dans la nature…
Mais personne n’est à suivre aveuglément. La communication et l’écoute étant les bases de la cohésion. Rendre compte et prendre en compte. Une liaison permanente (ou quasi permanente pour un groupe restreint) doit être de mise entre les individualités. Personne ne part ou ne reste seul.
Puisque les différents composants d'un groupe, individus, matériels, connaissances, informations, sont une même structure. Celle qui s’optimise par l'organisation pour influencer les probabilités.
Et ton job au sein d’une équipe de survivants n’est pas de revenir, mais de ramener les autres. Leur job à eux n’est pas de revenir, mais de te ramener.


"décider, jamais stagner"
Toute réduction de risque coûte.
Le matériel se porte, diminuant la mobilité. Prendre une route plus sûre mais à sens unique, fait perdre en flexibilité stratégique. S’activer pour limiter un potentiel danger, engage de l’énergie, etc.
Ce pourquoi l’analyse précède la décision opérationnelle. Qui doit quand même être prise, en fonction de l'urgence, plus ou moins rapidement.
Il s’agit d'évaluer le plus objectivement possible la gravité d’une potentielle menace ainsi que sa probabilité. Puis on ajoute dans
la balance le coût de la réduction du risque.
Soit ce dernier est acceptable, soit on choisit de le réduire, ou bien carrément de ne pas le prendre (quand cela est possible).
Imaginons une piste surplombée d'une falaise dont la roche a visuellement l’air stable. Un éboulement serait potentiellement grave, tu pourrais y laisser la vie. Toutefois, cela a suffisamment peu de chance d’arriver pour que tu choisisses de rien faire de plus. Tu passes en étant, comme toujours, attentif.
Imaginons maintenant que le sentier qui longe le pied de cette même falaise ne soit guère large, paraissant de surcroît très instable. En ce cas, il vaut peut-être mieux envisager une autre voie de passage.
Si emprunter ce sentier est la seule option, tu traverses ou tu fais demi-tour. Mais quel sera le coût éventuel d'un retour en arrière ?
Sur le terrain, personne ne décidera à ta place ou à la place de ton groupe !
En tous les cas, on cherche plus à atténuer la probabilité d’un risque que sa gravité. En gardant notre précédent exemple, il est plus aisé d’éviter de se trouver dans un éboulement que d’essayer d’en minimiser les dégâts.
C’est seulement quand le choix n’en est plus un, que la probabilité n’en est plus une puisque devenue certitude, qu’on cherche à limiter les dommages. C’est à cela que sert une trousse de secours.
Toutefois, tel que le dit l'adage, mieux vaut prévenir que guérir.


© Popasus 2025 - Tous droits réservés